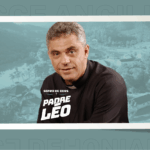Espérance, moteur de la vie consacrée et de la mission au service des autres
L’année 2025 a été décrétée par le Pape François, de regrettée mémoire, une année jubilaire et le thème devant guider les fidèles tout au long de cette année jubilaire est l’espérance, une des vertus théologales. Nous nous proposons dans cet article de réfléchir sur l’espérance comme le moteur de la vie consacrée et de la mission au service des autres. Nous commencerons d’abord par l’éclairage sur la vertu de l’espérance et son lien avec les deux autres vertus théologales, la foi et la charité, avant de nous montrer en quoi elle peut être motrice de la vie consacrée et de la mission des personnes consacrées.
L’espérance et les autres vertus théologales
L’espérance est la deuxième vertu théologale après la foi. Les vertus théologales sont au nombre de trois : la foi, l’espérance et la charité. Nous affirmons la vertu d’espérance dans l’acte d’espérance que nous récitons dans nos prières :
Mon Dieu, j’espère avec une ferme confiance
que vous me donnerez, par les mérites
de Jésus-Christ, votre grâce en ce monde et
le bonheur éternel dans l’autre, parce que
vous l’avez promis et que vous tenez
toujours vos promesses.
Amen.
L’espérance est donc une disposition du croyant qui consiste à avoir confiance en la réalisation des promesses de Dieu dans cette vie présente et celle du monde à venir. L’espérance a pour contenu l’attente, la confiance et la patience. L’aboutissement des promesses n’est pas bien connu du croyant, ni le moment, ni le mode. Mais le croyant s’appuie sur la confiance en Dieu avec la ferme conviction sur l’obtention de l’objet de la promesse. On peut ne pas toujours avoir la clarté sur l’aboutissement de ces promesses et c’est pourquoi, il est plus question de s’en remettre à Dieu, de ne compter que sur la relation qu’il désire instaurer entre le croyant et lui. Si nous parlons de l’attente, elle n’est donc pas nécessairement d’ordre temporel mais plus eschatologique. Le Christ nous enseigne à vivre dans l’attente et l’espérance de la manifestation de la gloire que Dieu réserve à chacun de nous dans cette vie présente mais surtout dans la consommation des temps. L’espérance nous fait désirer et attendre la vie éternelle en Dieu. Elle renforce notre confiance dans les promesses de Dieu en ne comptant que sur Notre Seigneur Jésus-Christ et la grâce de l’Esprit Saint. Pour maintenir constante l’espérance, il faut s’armer de la vertu de la persévérance dans l’attente. Elle consolide et soutient la patience.
Ce qui caractérise l’espérance chrétienne est que la vie ne finit pas dans le néant. La vie chrétienne est un chemin qui a besoin des moments fort pour se nourrir de l’espérance. « Se mettre en marche est la caractéristique de celui qui va à la recherche du sens de la vie. »
Il convient cependant de dire que l’attente n’est pas dans la passivité ou dans l’oisiveté. Parlons de la relation entre l’espérance et la foi chrétienne d’une part, l’espérance et la charité d’autre part avant de voir comment devrons-nous, en tant que consacrés, vivre et propager cette vertu d’espérance ?
1.1. L’espérance et la foi chrétienne
La vie chrétienne est un pèlerinage dans la foi en étant guidé par l’espérance. L’espérance n’est ni optimisme ni positivisme, mais fruit d’une ferme croyance nourrie par la Parole de Dieu, qui affecte notre attitude sur les événements quotidiens, les devoirs de charité et de tolérance enracinés dans la transformation de notre humanité selon le plan de Dieu. Notre foi est toujours une marche, un pèlerinage vers la consommation des temps, c’est-à-dire la parousie ou le retour du Christ pour le jugement dernier. L’épître aux Hébreux décrit la foi comme « une façon de posséder ce que l’on espère, un moyen de connaître des réalités qu’on ne voit pas. » (Hb 11, 1). L’épître poursuit en montrant comment l’espérance a été le moteur du vécu de la foi et de la mission de nos ancêtres dans la foi : Abel, Enoch, Noé, Abraham, Sarah, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, Samson, Jephté… (Hb 11, 1-40). Ils ont enduré de grandes épreuves et triomphé grâce à la vertu de l’espérance. Ils n’ont pas eux-mêmes vu la réalisation de l’objet de leur espérance de leur vivant mais la confiance dans cette réalisation a été le but de leur persévérance dans l’attente. L’espérance est l’arme qui aide le croyant à vaincre la peur et à endurer de pénibles épreuves. Elle permet d’affronter les vicissitudes de la vie présente si pénibles qu’elles soient. Saint Paul encourage les fidèles de Thessalonique en ces termes : « Vous ne devrez pas être abattu comme les autres qui n’ont pas d’espérance. » (1 Th 4, 13). Si l‘espérance venait à manquer la foi et la vie chrétienne manqueraient de sens. Les chrétiens ne pourront ni être le sel de la terre, ni le levain dans la pâte. Ils seront à la trame des idéologies, des roseaux qui se courbent au gré des vents (Ps 1, 4). C’est en ce sens que l’espérance entraîne et vivifie la foi.
Notre crédo Nicée-Constantinople est trinitaire autrement dit, il confesse les trois personnes en seul Dieu et peut être divisée en trois parties : la question de Dieu (création et transcendance), la question christologique (incarnation et rédemption), la question de l’Esprit-Saint qui vivifie l’Eglise et les croyants. Cette dernière partie s’achève par la formulation de l’espérance chrétienne : « J’attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. » Cette vie du monde à venir, le croyant ne la connaît pas dans les détails mais il a l’assurance que le futur ne débouche pas sur le vide ou le néant. Cette assurance l’aide à donner sens sur la vie présente parce qu’elle s’ouvre sur l’avenir. Grandir dans la foi et notre vocation missionnaire dans le monde présent aide à faire face aux vicissitudes dans le train-train quotidien et de justifier nos efforts dans ce voyage qui nous conduit vers cet horizon futur qu’on espère. Cette foi en la vie future a aidé les chrétiens de l’Eglise primitive à endurer les persécutions, les tribulations et même la mort. Ainsi, l’espérance motive d’autres vertus comme le courage la force et la tempérance qui permettent à leur tour au croyant de toujours se dépasser dans sa situation présente pour se projeter dans l’avenir et dans l’eschatologie.
Par ailleurs, l’espérance fait partie de la nature des êtres créés à l’image et à la ressemblance de Dieu (Ep 1, 3-5) ; saint Thomas d’Aquin décrit la foi comme la substance des choses pour lesquelles on espère, la disposition stable de l’esprit à travers laquelle la vie éternelle prend racine en nous. La foi contient des choses pour lesquelles nous espérons ; elle nous aide à réaliser ce qui demeure encore invisible et l’espérance nous conduit à la sûreté que par la grâce de Dieu, elle s’accomplira. L’espérance nous conduit à voir le triomphe au bout de nos peines et nous mobilise à fournir davantage d’effort pour la réalisation de ce que nous poursuivons.
La foi conduit nécessairement à l’espérance. L’espérance étant l’attente de l’accomplissement des promesses de Dieu. Croire, c’est s’abandonner comme Abraham à Dieu dans une aventure sans sécurité, s’appuyant seulement sur la confiance dans sa Parole. C’est l’espérance à notre salut définitif, garanti des biens qu’on espère, preuve des réalités qu’on ne voit pas (Hb 11, 1). L’engagement extraordinaire des premiers chrétiens était soutenu par la foi en la venue éminente du Christ (1 Th 5, 2). Elle stimulait en eux, vigilance et détermination à affronter les situations difficiles (Rm 13, 11-14). Cette assurance constitue un stimulant pour nous mettre au service et une ancre sûre et solide qui nous maintient ferme dans l’engagement. Quand les fidèles perdent ou s’éloignent de la foi ou l’espérance dans les réalisations des promesses de Dieu, ils ne s’engageront plus dans la transformation du monde ou mieux, ils ne se donnent plus pour l’évangélisation. On pourrait donc dire que l’espérance est une force qui dynamise la foi et l’engagement du croyant.
1.2 Espérance et charité
La Constitution pastorale Gaudium et spes dit dans son préambule : « Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ, et il n’est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur. Leur communauté, en effet, s’édifie avec des hommes, rassemblés dans le Christ, conduits par l’Esprit Saint dans leur marche vers le Royaume du Père, et porteurs d’un message de salut qu’il faut proposer à tous. La communauté des chrétiens se reconnaît donc réellement et intimement solidaire du genre humain et de son histoire. » L’espérance soutient l’engagement chrétien à aimer davantage et à faire le bien en supportant aussi les souffrances et les adversités et de travailler avec détermination pour son salut et celui de ses frères et sœurs. L’espérance mobilise donc les énergies pour la transformation du monde à travers la fructification des talents ou des charismes que l’Esprit Saint a mis en nous. Au sujet de la parabole des talents, le troisième bénéficiaire n’a pas fructifié son talent parce qu’il n’avait pas d’espérance contrairement aux deux premiers qui ont espéré d’abord que le talent pourrait produire et aussi que les fruits pourraient être bénéfiques pour leur maître (Mt 25, 24-25). L’espérance libère de la peur mais aussi de l’égocentrisme et ouvre à la générosité envers Dieu et envers le prochain. En ce sens, saint Paul s’adresse aux chrétiens de Rome : « Je vous exhorte donc, frères, par la miséricorde de Dieu, à offrir vos personnes en hostie vivante, sainte, agréable à Dieu : c’est là le culte spirituel que vous avez à rendre. Et ne vous modelez pas sur le monde présent, mais que le renouvellement de votre jugement vous transforme et vous fasse discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. » (Rm 12, 1). L’espérance ouvre à la construction d’un avenir meilleur. En effet, le message chrétien n’est pas seulement informatif mais aussi performatif. Il appelle à produire des faits dans la vie de chaque jour. Il appelle les chrétiens à anticiper le règne de Dieu.
2. L’espérance au cœur de la vie consacrée
Nos congrégations religieuses sont la réalisation de l’utopie de leurs fondateurs. L’idéal des fondations est porté par un désir d’être plus proche de Dieu, de l’aimer et le servir davantage. L’idéal est une tension vers la perfection, la vie béatifique. La vie consacrée naît souvent des crises dans l’Eglise ou dans la société et les fondateurs d’ordre en développant une spiritualité ou un idéal de vie, veulent ouvrir une brèche pour la sortie de la crise. Ils sont alors comme des porteurs d’espérance pour l’Eglise et pour la société de leur temps. La vie consacrée est depuis les origines, un appel à vivre la radicalité évangélique pour éveiller la conscience des hommes à travailler pour se rapprocher davantage de Dieu. Elle est toujours une recherche pour la perfection ou la sainteté qui est là et par encore. Quand nous révisons la fondation de nos ordres, nous allons découvrir que les fondateurs ont tous été des aventuriers qui parfois ont navigué à vue ; ils ont par moments été tentés d’abandon du projet ou de sombrer dans la lassitude, mais qu’il a fallu cette vertu d’espérance pour qu’ils continuent à poursuivre leur idéal. Comme exercice, chacun peut revenir sur la fondation de son ordre et repérer les moments de découragement et de chancellement et aussi comment nos fondateurs ont ressaisi de nouveau l’espérance pour s’y accrocher et continuer leurs œuvres.
Leurs disciples, que nous sommes, en nous adhérant à leurs idéaux, sommes aussi à la recherche d’une sainteté de vie. La sainteté de vie est de l’ordre de l’espérance. On la poursuit à travers la conversion permanente de vie. L’espérance draine la force pour le renouvellement personnel et le renouvellement de l’Eglise. Si nous parcourons aussi l’histoire de nos vocations – et il faut toujours la parcourir – nous allons nous rendre compte que les moments où nous avons le plus faibli, ce sont les moments où nous étions en crise d’espérance.
L’espérance est fruit d’une forte croyance nourrie par la Parole de Dieu dans la Bible, implémentée dans nos attitudes dans les événements quotidiens, les faits et les actes de charités, la tolérance vis-à-vis des autres. Elle est la motivation qui nous maintient attachés à notre mission d’être créatifs dans les réponses aux difficultés et aux défis et de continuer à découvrir le chemin malgré le brouillard qui assombrit l’avenir. Elle est la lumière qui illumine nos moments sombres et nous maintient fermes dans notre marche vers le but ultime tout en faisant aussi de nous des lumières pour ceux qui sont confiés à notre mission ; leur faire suivre le chemin pour leur salut.
Nous religieux et religieuses avons la mission de forger la destinée des peuples qui vivent des situations désespérées. En fait c’est de reproduire la mission du Christ que nous lisons dans l’évangile qui consiste à rendre crédible cet évangile en le vivant et en libérant les hommes et les femmes de différentes captivités. Comment nous déployons-nous dans cette mission de donner l’espérance aux peuples désespérés ?
3. Mission de l’espérance dans l’annonce et le témoignage
Les religieux, comme tout chrétien, sont appelés à être sel, lumière et levain partout où ils se trouvent. Donner témoignage de leur foi exige qu’ils ne soient pas une charge pour eux-mêmes ou pour la société, mais plutôt des semeurs d’espérance conscients de leur mission de donner goût au monde, de l’illuminer de la lumière de l’évangile et de le transformer en réceptacle de vertus.
Comme nos fondateurs et fondatrices, nous sommes appelés à scruter les signes des temps que nous offre le Seigneur pour répondre d’une manière adaptée aux défis dans notre Eglise et nos sociétés. Nos charismes et spiritualités sont variés et peut-être le contexte d’aujourd’hui est différent de celui du temps de nos fondateurs mais nous devrons toujours chercher à les rénover de sorte qu’en les vivant, nous soyons des porteurs d’espérance à nos contemporains. Nous avons des congrégations qui ont été fondées sur une œuvre spécifique pour répondre à un besoin de la société ou de l’Eglise mais qu’aujourd’hui le besoin n’existe plus. L’œuvre va-t-elle mourir ? Non, car le charisme ou la spiritualité nécessite toujours une réinterprétation et une adaptation au temps. L’œuvre de la Merci fondée au XIIe siècle pour le rachat des esclaves a subsisté au temps même si l’esclavage classique a presque pris fin. L’ordre se déploie aujourd’hui à réfléchir sur les esclavages modernes et à chercher comment affranchir ou soulager ou libérer ceux et celles qui en sont victimes. Les membres travaillent maintenant pour les refugiés, non seulement pour leur apporter les moyens ou des solutions à leurs problèmes basiques (se nourrir, se vêtir, trouver un logement) mais aussi pour leur intégration dans la société d’accueil, les aider à régulariser leur situation, à trouver un travail décent sans souffrir de beaucoup de tracasseries. Le faisant, les Frères et les Pères sont des missionnaires de l’espérance auprès des réfugiés. An ce sujet, saint Jean Paul II nous exhorte dans Vita consecrata : « Vous n’avez pas seulement à vous rappeler et à raconter une histoire glorieuse, mais, vous avez à construire une grande histoire! Regarder vers l’avenir, où l’Esprit vous envoie pour faire de grandes choses. »
Une dimension de la vie consacrée qui peut aider à faire des religieux et religieuses à entretenir l’espérance du peuple est la dimension prophétique. Les religieux, par leur mode de vie et leur prédication, luttent contre ce qui déshumanise pour redonner courage aux hommes et aux femmes sans espérance. Ils sont appelés à la suite du Christ à délivrer les hommes et les femmes des différentes captivités des idoles (richesses, sexes, pouvoir). Nous sommes invités à imiter le Christ dans le vécu de cette dimension prophétique en nous appropriant sa mission. Jésus est le prophète par excellence. A l’entame de son ministère publique, il s’approprie à la synagogue de Nazareth, Is 61, 1-2 : « L’Esprit du Seigneur est sur moi : il m’a consacré pour donner aux pauvres une bonne nouvelle. Il m’a envoyé annoncer la libération aux captifs, la lumière aux aveugles ; libérer ceux qui sont écrasés, et proclamer une année de grâce de la part du Seigneur » (Lc 4, 18-19).Sans avoir rien contre les richesses, puisqu’il aura même des amis riches comme Joseph d’Arimathie et fréquentera même Zachée aux acquisitions douteuses des richesses, il les désacralise. Il va s’élever contre la dictature des biens qui réduit en esclavage les hommes, réduit les relations entre les hommes, les peuples et les nations à une affaire d’intérêt, crée des dépendances, fait obstacle à l’amitié et à l’amour. L’accumulation des richesses fait obstacle au partage et à la charité (le riche et Lazare (Lc 16, 19-31), expose à la cupidité (Judas (Mt 6, 47)), l’orgueil, l’arrogance, l’écrasement des pauvres et la tentation de prendre la place de Dieu (Le riche insensé (Ps 53, 2 ; Lc 12, 15-20)), la corruption (soldats achetés pour mentir sur la résurrection du Christ (Mt 28, 15)). La grandeur chez le Christ n’est pas dans le pouvoir et les possessions mais dans le service (Jn 13, 1-20). Celui qui veut être grand doit prendre la place de celui qui sert (Lc 22, 27).Alors que tout le monde lutte pour dominer, pour gagner, pour se servir, le religieux va lutter pour se débarrasser de ces sollicitations de son cœur, il va le désencombrer de ces désirs si légitimes qu’ils soient et ne trouver sa joie que dans le service qu’il rend à ses frères et sœurs. Le Christ est venu pour servir et non pour être servi (Mc 10, 45). De conditions divines qu’il était, il est devenu homme. Ne se contentant pas seulement de la condition humaine, il a pris la place du dernier homme, de l’esclave qu’on exécute sans tenir compte de sa dignité, tout cela pour servir l’humanité et l’exalter (Ph 2, 6-8). Les religieux doivent être dans le monde une présence exaltante de la dignité humaine.
La pauvreté prophétique est libératrice. Elle consiste dans le don, la gratuité, la disponibilité à rendre service, stimuli de transformations de la société. Les religieux et religieuses défendent contre tout ce qui déshumanise, par le travail qui ne cherche pas nécessaire l’acquisition de la promotion ou et des biens à tout prix.
4. Quelques lieux féconds pour la semence de l’espérance
- Milieu éducationnel. Le sage Confucius disait : « si ton plan est pour une année, plante le riz. Si ton plan est pour dix années, plante les arbres mais si ton plan est pour cent ans éduque les enfants. » Les religieux sont des éducateurs de conscience et l’éducation est un facteur d’espérance. A travers elle, ils aident les peuples à faire face à leur situation présente et future. Nous sommes invités à inventer des pédagogies porteuses d’espérance dans nos écoles, nos couvents, nos apostolats. Nos jeunes bien que formés n’arrivent pas à se prendre en charge. Nous ne pouvons pas seulement attribuer la faute à la conjoncture et ne pas questionner si nos manières de former donnent vraiment l’espoir. Certes, on s’efforce de former la qualité dans nos écoles mais à l’instar des religieux comme Angèle de Medecis, Don Bosco, nous devrons inventer des pédagogies préventives et curatives pour aider notre jeunesse et nos peuples à apprendre à être aussi inventifs ou créatifs. D’où le Pape nous invite à œuvrer dans le monde de la jeunesse. Il écrit : « il est triste de voir des jeunes sans espérance. Lorsque l’avenir est incertain et imperméable aux rêves, lorsque les études n’offrent pas de débouchés et que le manque de travail ou d’emploi suffisamment stable risque d’annihiler les désirs ; il est inévitable que le présent soit vécu dans la mélancolie et l’ennui. L’illusion des drogues, le risque de la transgression et la recherche de l’éphémère créent, plus en eux que chez d’autres, des confusions et cachent la beauté et le sens de la vie, les faisant glisser dans des abîmes obscurs et les poussent à accomplir des gestes autodestructeurs. C’est pourquoi le Jubilé doit être dans l’Église l’occasion d’un élan à leur égard. Avec une passion renouvelée, prenons soin des jeunes, des étudiants, des fiancés, des jeunes générations ! Proximité avec les jeunes, joie et espérance de l’Église et du monde ! »
- Le dialogue. Les religieux doivent ouvrir le chemin pour le dialogue entre les peuples de différentes cultures, de différentes religions, de différents âges, de différentes conditions sociales. Le dialogue promeut l’unité dans la diversité et donne crédit à leur témoignage. Dans le dialogue, les religieux n’apportent pas seulement aux autres, ils reçoivent aussi des autres et valorisent ce dont ils reçoivent d’eux. Les moines ont longtemps été des agents de développement de l’agriculture et même des sciences profanes. A la chute de l’empire romain, c’est eux qui sauvèrent le patrimoine artistico-littéraire du monde antique des destructions barbares et conquièrent les forêts pour amener les peuples à apprendre à se former et à se prendre en charge par la mise en valeur des terres. Ils ne se contentaient pas de garder le patrimoine de l’antiquité mais aussi de le développer et le faire valoir pour donner espoir à la jeunesse et aux hommes assoiffés de savoir. Les religieux ne doivent pas fuir ou prendre du retard sur la maîtrise des outils informatiques qui sont à la mode aujourd’hui. Ils sont appelés à humaniser l’Intelligence artificielle et être même en avant-garde d’autres nouveaux moyens de communication.
- Les religieux ont la mission de maintenir vive la flamme de l’espérance dans l’Eglise et dans le monde à travers leur style de vie, leur courage, leur dévotion. Leur vie communautaire et la fraternité qui y découlent, produisent le témoignage qu’il est possible de vivre en paix et en harmonie avec les gens différents de par la langue, la culture, les goûts, les âges, les conditions sociales… Leur vie en commun suscite des vocations, autrement dit, attire des jeunes gens qui sont à la rechercher d’un avenir. Le manque de vocation est signe que les religieux ne créent plus individuellement ou communautairement de l’espérance pour la jeunesse.
Conclusion
Il faut croire que nos vies sont toujours porteuses de la mission d’espérance auprès des autres même à notre insu. Je conclus par une histoire que j’ai suivie dans une vidéo dans les réseaux sociaux : Je la résume ainsi : Les meilleurs jours de nos vies sont parfois ceux que nous avons crus être les pires ou les jours où les raisons d’espérer nous ont manqué.
Un dimanche soir, un prêtre arrive à l’église pour dire la messe comme il avait l’habitude. A l’heure habituelle de la messe, personne n’est là. Il patiente et quelques 15 mn après, trois petits enfants entrent et prennent place à l’Eglise. Après 10 autres minutes, deux adolescents entrent à leur tour à l’Eglise. Il décide de commencer la messe avec les cinq personnes. Au cours de la messe, un couple entre et prend place au fond de l’église. Pendant l’homélie, voilà qu’un homme sale entre à l’église avec des cordes en main. Le prêtre ne comprend pas pourquoi les gens de la localité sont devenus si peu engagés mais ne se laisse pas affecté par sa déception. Il prêche avec zèle et dévotion. Sur le chemin retour chez lui, il est battu par deux bandits qui arrachent tout ce qu’il avait sur lui jusqu’à sa malle-chapelle. Regagnant sa maison, il bande ses plaies, fait le bilan de sa journée et déclare : ça s’est la pire journée de ma vie, le jour où j’expérimente l’échec de mon ministère, le jour infructueux de ma carrière mais peu importe! J’ai tout essayé pour le Seigneur.
Après sept ans, le prêtre, en prêchant dans la même église, revient sur ce triste jour. Lorsqu’il finit son homélie, voilà qu’un couple l’arrête et lui dit : « Père, le couple qui était entré quand la messe avait commencé, c’était nous. Nous étions sur le bord du divorce à cause de beaucoup de mésententes et des problèmes que nous avions au foyer. Nous nous sommes dits, avant de nous séparer, allons une dernière fois à l’église comme nous avions l’habitude. Mais votre homélie nous a remués au fond de nous-mêmes au point que nous avons cru que vous prêchiez uniquement pour nous. Du retour à la maison cette nuit-là, nous nous sommes retrouvés en train de minimiser nos problèmes et mésententes et nous voici aujourd’hui formant une famille toujours unie. » Après l’intervention du couple un célèbre entrepreneur qui a aidé beaucoup de pauvres de la localité et contribué énormément à la réfection de l’église demande la parole. « Père, dit-il, je suis l’homme sale qui est entré avec les cordes en main. J’avais fait faillite et me suis lancé dans l’alcool et la drogue. Ma femme et mes enfants m’avaient abandonné à cause de mon comportement. Ce jour-là, j’avais acheté une corde pour me suicider et quand je me suis lancé après l’avoir mise au cou, elle s’est coupée et je suis allé acheter d’autres plus solides. Mais en passant par ici, j’ai vu l’église ouverte et je me suis dit que j’allais un peu me distraire en y entrant. Votre homélie m’a percé le cœur et de retour à la maison, j’ai changé d’idée et commencé à travailler pour abandonner l’alcool et la drogue. J’ai commencé à m’investir dans le travail et aujourd’hui, ma femme et mes enfants m’ont rejoint à la maison et nous formons une famille heureuse et je suis un des grands entrepreneurs de la ville.
A la porte de la sacristie, le diacre déclare : « Mon Père, je suis l’un des bandits qui vous avaient brutalisé et emporté tout ce que vous aviez ce soir-là. Mon compagnon a été tué quand après vous, nous faisions le prochain brigandage. Lorsque j’ai cassé votre male-chapelle, j’ai vu votre Bible et commencé à la lire de temps en temps. J’ai pris plaisir à écouter la parole de Dieu et commencer à fréquenter cette église. Et c’est ainsi que j’ai découvert ma vocation et aller au séminaire.
A la fin le prêtre s’est mis à pleurer et ses fidèles l’ont suivi dans les pleurs. Mais les pleurs de joie résultant de la découverte que les jours où nous croyons être les pires de nos vies sont parfois ceux où Dieu opère le plus de miracles. Et de là, il ne faut pas perdre l’espérance en aucune circonstance quelle que douloureuse qu’elle soit. Le Seigneur est toujours avec nous.
C’est pour dire de ne jamais nous décourager, même quand nous subissons le martyre, de croire que nous sommes toujours en mission et porteurs d’espérance, instruments de la réalisation des desseins de Dieu de sauver l’humanité parfois qui manque d’espérance.